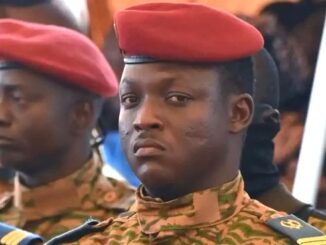Le projet Transition des Systèmes agricoles et alimentaires sur les territoires (TERSAA) a été clôturé jeudi à Lomé par un atelier de capitalisation sur les systèmes alimentaires territoriaux (SAT).
Coordonné par Acting For Life (une ONG qui soutient l’émergence et le développement de projets territoriaux auprès d’organisations locales), ce projet a été mis en œuvre de novembre 2020 à février 2024, dans des exploitations familiales de cinq pays dont le Togo. Il s’agissait de garantir la disponibilité et l’accès à des aliments de qualité (produits localement) auprès des consommateurs.
Au Togo, il a été conduit par l’Organisation pour l’alimentation et le développement local (OADEL), et a permis de réaliser la cartographie des systèmes alimentaires des communes Golfe1 et Golfe2, et d’élaborer un document SAT (Système alimentaire territorialisé) pour ces deux communes.
Selon Mme Nadège Tougan (chargée du projet), le bilan est en majeure partie positive car, les activités prévues sur le projet TERSA ont été exécutées pour la plupart, et les résultats atteints.
« Il y a eu en l’occurrence des foires dans les communes, des petits déjeuners solidaires dans les écoles pour sensibiliser les jeunes à la consommation locale, des activités avec les unités de transformation agroalimentaire en ce qui concerne la démarche qualité, l’appui à l’obtention de certificats, etc », a dit Mme Tougan.
Notons que le projet TERSA intègre également les systèmes alimentaires territorialisés, un volet qui a été conduit avec les communes. Ce projet a toutefois fait face à des difficultés liées notamment à la lourdeur administrative.
« Le projet TERSA a rencontré assez de difficultés, en l’occurrence la lourdeur administrative, la nonchalantes et le manque de réactivité des communes. Cette situation a fait que, nous n’avons pas pu avoir accès aux données liées à l’évaluation de la commande publique, suite à l’exhortation de Mme la ministre pour la consommation des produits », a-t-elle longuement expliqué.

Systèmes alimentaires territorialisés : les Communes Golfe 1 et Golfe 2 des exemples
« Ces commandes n’ont pas pu être évaluées faute de données désagrégées. La collaboration avec les communes a été plus ou moins difficile pour la plupart des communes. Avec la plupart des communes, la collaboration n’a pas été facile. Mais, malgré cela, il y a eu deux communes qui se sont démarquées, avec lesquelles la collaboration a été assez facile Il s’agit des communes Golf 1 et Golf 2 ».
« Avec OADEL, on a compris l’importance de manger qualité, on consommait des produits chimiques. Grâce à OADEL, nous avons revalorisé nos aliments, et c’est ça qui nous donne, sans mentir, la santé. Et avec OADEL, nous avons travaillé en parfaite symbiose », a dit Koffi Boko (premier adjoint au maire de la Commune du Golfe 1).
« Notre santé dépend de notre alimentation. Donc, quand OADEL a amené son projet de consommer bio, nous avons saisi ce projet dans notre commune avec notre maire, Kouami Gomado en tête. Le projet prend fin aujourd’hui, certes, mais c’est entré dans nos habitudes désormais Et nous avons bien évolué, et le comportement est bien entré chez nous à la commune de Golfe », a dit M.Boko.
Même satisfaction et même élan au sein de la commune Golfe 2 : « C’est un projet que nous avons pris à bras le corps et apprécié. Il faut avoir une alimentation saine pour avoir une meilleure santé et vivre dans un environnement sain. Il faut donc commencer déjà à changer de mentalité à la base par rapport à notre alimentation, qu’on privilégie les aliments de qualité, les aliments sains. Nous, nous avons déjà commencé par faire le relais au niveau de nos structures de base, et nous changerons de mentalité pour mieux vivre », a expliqué Alfa Wiyaou (Conseiller du président de la commune Golfe 2).
Au nombre des leçons tirées, figurent la nécessité de miser sur la communication rapprochée avec les communes, celle d’informer assez tôt les groupes cibles et les sensibiliser sur le bien-fondé du projet, afin qu’ils puissent l’intégrer à leur mode de fonctionnement, à leur plan d’action commune. FIN
Ambroisine MEMEDE